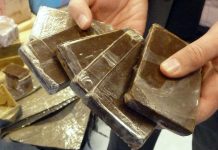Wassila. B
Le refus par la justice française d’extrader Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre algérien de l’Industrie condamné par la justice en Algérie à cinq peines de 20 ans de prison pour corruption et malversations financières, illustre les contradictions de la France en matière de coopération judiciaire internationale. L’Algérie a présenté à la France, où il est installé, six requêtes pour son extradition, en vain. L’Algérie a pris acte de la décision de la justice française, a la Cour d’Aix-en-Provence en l’occurrence, d’opposer une fin de non-recevoir à la demande d’extradition d’Abdeslam Bouchouareb. « Sans préjudice du recours à d’autres voies de droit encore possibles, le gouvernement algérien saisit cette occasion pour relever l’absence totale de coopération du Gouvernement français en matière d’entraide judiciaire en dépit de l’existence de nombreux instruments juridiques internationaux et bilatéraux prévus à cette fin », indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines. Le même communiqué souligne que « dans le cadre de ses efforts visant à récupérer toutes les richesses dont elle a été spoliée, l’Algérie s’est systématiquement heurtée et se heurte toujours à des tergiversations et à des atermoiements injustifiés et inexplicables de la partie française qui ont abouti à une absence totale de réponses à vingt-cinq commissions rogatoires introduites par l’Algérie ». Malgré des instruments juridiques clairs et des engagements internationaux, la France oppose une fin de non-recevoir à la demande d’extradition de l’Algérie, mettant en filigrane des motivations politiques sous-jacentes et inavouées. Ce refus contraste avec la coopération loyale d’autres pays européens, alimentant un débat sur le deux poids, deux mesures dans la lutte internationale contre les biens mal acquis. La France et l’Algérie sont liées par des conventions bilatérales et multilatérales, dont la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003) et l’accord d’entraide judiciaire pénale franco-algérien de 2004. Ces textes imposent une obligation de coopération, notamment pour les crimes graves comme la corruption. Pourtant, Paris invoque des motifs opaques pour bloquer l’extradition de Bouchouareb, condamné pour des faits graves mais qu’elle protège sur son territoire. Les avocats algériens dénoncent une violation des principes de réciprocité et de bonne foi, soulignant que les preuves à l’origine de sa condamnation en Algérie ont été validées par des tribunaux nationaux. Contrairement à la France, plusieurs États européens ont répondu positivement aux demandes algériennes dans le dossier des biens mal acquis. L’Italie, l’Espagne et la Suisse ont notamment gelé des avoirs ou facilité des restitutions, reconnaissant la légitimité des procédures judiciaires engagées par Alger. Cette dichotomie interroge : pourquoi la France, historiquement engagée dans la lutte contre la corruption transnationale, adopte-t-elle une posture aussi contradictoire ? Si la France invoque parfois le principe de dualité criminelle (l’exigence que les faits soient punis dans les deux pays), les lourdes charges gravissimes retenues contre Bouchouareb -détournement de fonds publics, abus de pouvoir- sont pourtant inscrites dans le droit français. Le refus persistant suggère une stratégie calculée. Ce refus politique a pour conséquence un affaiblissement de la crédibilité Internationale de la France. Ce blocage fragilise l’image de la France comme respectueuse de la justice universelle. En contournant ses propres engagements, elle ouvre la porte à des accusations de cynisme. Pour l’Algérie, ce refus est perçu comme un déni de justice, alimentant un sentiment d’impunité pour les corrompus à l’abri à l’étranger.
L’affaire Bouchouareb dépasse le cadre judiciaire : elle symbolise l’urgence d’une coopération internationale désintéressée. La France, en choisissant de ne pas aligner ses pratiques sur celles de ses partenaires européens, a raté une occasion de restaurer sa crédibilité et honorer ses obligations. C’est l’efficacité même des conventions contre la corruption qui risque d’être durablement davantage mise à mal, au détriment des peuples victimes de ces délits. Ce refus appelle à une réflexion sur l’impératif de cohérence entre les discours politiques et les actes judiciaires, dans un monde où la lutte contre la corruption exige une collaboration sans frontières ni calculs politiciens.