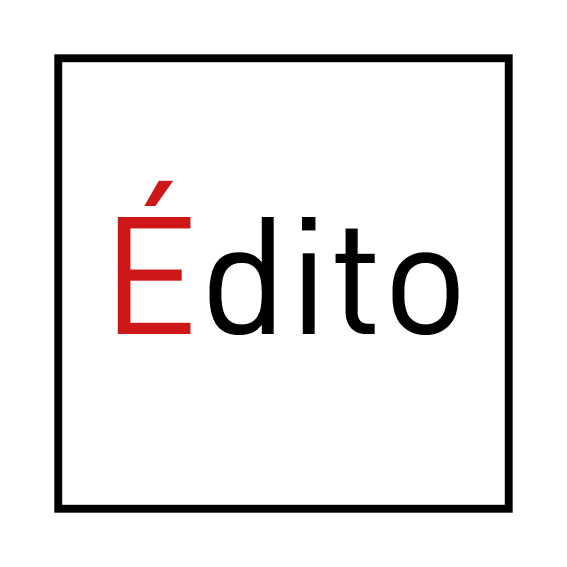Alger s’apprête à accueillir une conférence nationale d’une portée inédite : la modernisation de l’agriculture algérienne. L’événement, voulu par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, rassemblera une élite d’experts nationaux et internationaux autour d’un objectif clair : assurer la sécurité alimentaire durable du pays. Derrière cette initiative se dessine une ambition nouvelle, celle d’un État décidé à replacer son agriculture au cœur du développement économique et territorial. La feuille de route annoncée est ambitieuse : numérisation du secteur, optimisation de l’eau, modernisation des infrastructures, recours à la biotechnologie, mais aussi réorganisation institutionnelle. C’est une vision globale, tournée vers la productivité mais aussi vers la durabilité, un mot longtemps négligé dans les politiques agricoles. La nouveauté réside aussi dans la méthode : le dialogue. Pour la première fois, chercheurs, cadres du secteur et acteurs économiques sont appelés à co-construire une stratégie commune. Une ouverture salutaire, réclamée de longue date par le monde académique et par les professionnels. Des voix s’élèvent pour mettre tous les acteurs sur la même longueur d’onde. Des agro-économistes insistent sur l’urgence de former et d’équiper les exploitants afin d’intégrer pleinement la technologie dans les champs et les fermes. Il est vrai que la numérisation reste embryonnaire : trop de paperasse, trop peu de données. Le dernier recensement agricole de 2024 n’a toujours pas livré ses chiffres. Comment planifier sans statistiques fiables ? Là encore, la conférence doit marquer un tournant : bâtir un système d’information agricole moderne, outil indispensable d’un pilotage efficace du secteur.
L’ouverture à la coopération internationale est un autre atout. Les partenariats fructueux avec des experts européens ou turcs, dans les filières du blé, de la betterave ou du lait, montrent la voie. Ces échanges permettent d’adapter des savoir-faire étrangers aux réalités locales et d’éviter les erreurs du passé, quand la vulgarisation agricole peinait à atteindre les exploitants.
Enfin, la dimension climatique ne peut être éludée. Dans les Hauts Plateaux, les sécheresses répétées rappellent la fragilité de la céréaliculture. La modernisation du dry-farming, ou culture en sec, devient une nécessité stratégique. Le président Tebboune a réaffirmé l’importance d’une conditionnalité des aides : tout agriculteur bénéficiant de subventions devra contribuer à la production nationale. C’est là une mesure de rigueur, mais aussi de cohérence. Le débat ouvre ainsi une nouvelle ère agricole. Celle d’une Algérie qui regarde son sol autrement, non plus comme un héritage épuisable mais comme un patrimoine à préserver, à gérer, à réinventer. De la steppe à l’oasis, du champ de blé à la serre numérique, le pays se met en marche vers une révolution verte raisonnée, alliant technologie, savoir et responsabilité. Avec cette dynamique, l’Algérie ambitionne de devenir un modèle régional d’agriculture durable, fidèle à sa terre et ouverte à l’avenir.